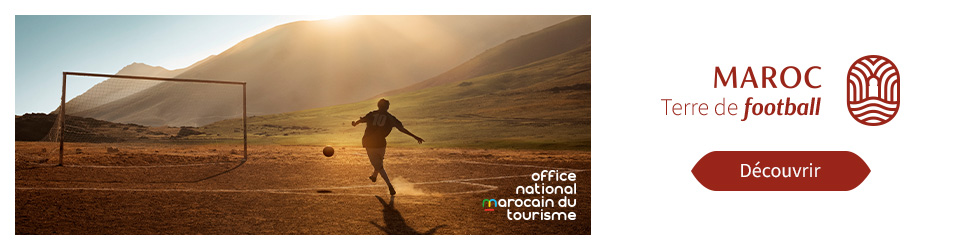Expurgeons cette «h’chouma» !

PAR HASSAN EL ARCH
Un mot, dans notre langage dialectal et toute notre culture orale, est lourd de sens et le restera probablement toujours, tant que nos restons attachés à nos valeurs. Ce mot est «h’chouma». Et le sens de ce mot va bien au-delà de la stricte définition sémantique («honte») qu’il suggère aux uns et aux autres. Il se nourrit aussi, selon les situations, de sentiments de gêne, d’embarras, de regret, voire de culpabilité ! Ce sont ces sentiments que l’on ressent à la vue de vieillards, hommes et (plus péniblement) femmes qui nous tendent la main pour mendier. La vue aussi de jeunes désœuvrés, moins usés par l’âge certes, mais qui n’en mendient pas moins…
Le Maroc de 2020 ne peut pas accepter que de tels clichés continuent de porter attente à sa dignité. Un pays qui a déployé, voilà maintenant une quinzaine d’années, un programme aussi colossal et structurant que l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH) ne peut tolérer que ses franges de population les plus vulnérables soient ainsi atteintes dans leur intégrité morale et physique.
Deux constats, deux maux, deux urgences. Parmi d’autres, bien entendu, mais ces deux réalités-là nous font mal en permanence, depuis trop longtemps et interpellent notre conscience où que l’on soit au Maroc. Elles nous sautent aux yeux, nous encerclent, nous révulsent et rendent plus vive la «h’chouma» que l’on en conçoit.
Dans le dossier central du présent numéro, nous faisons allusion à cette double réalité, parmi d’autres, dans le sillage d’un constat plus global qui pose, encore et toujours, la question du développement du Royaume. Une évidence s’impose lorsqu’on prend du recul avec ce problème : laisser les jeunes flâner à longueur de journée, dans des lieux malsains qui plus est, reste le meilleur moyen de bâtir une société sur des fondations fragiles. Vu l’abandon et l’oisiveté qui caractérisent le quotidien d’une partie de notre jeunesse, il urge d’imaginer des solutions socialement rentables et économiquement peu coûteuses. Le modèle des Maisons de Jeunes en est un exemple. On en a vécu l’expérience dans les années 70 et 80 du siècle précédent et des générations de jeunes y ont été accueillis, encadrés, formés et éduqués. Pourquoi faut-il donc oublier les formules qui marchent ? Réadapter ce qui a réussi, c’est sûr. L’améliorer, c’est souhaitable. Mais le passer à la trappe, non. Le raisonnement vaut aussi pour des centres d’accueil dédiés aux séniors, pouvant être bâtis et aménagés suivant le même modèle volontariste.
L’argent existe. Les bonnes volontés, aussi. Le sentiment de cette «h’chouma» sociale serait assurément moins fort, voire expurgé, si l’on s’en convainc en ce début 2020.