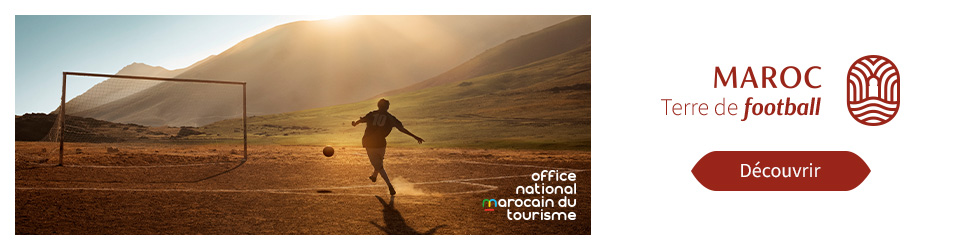Engagement citoyen au Maroc : une jeunesse prête à agir, mais vaguement désabusée

Loin des clichés d’une jeunesse désengagée, un nouveau rapport de l’Association Les Citoyens révèle un tableau nuancé et puissant de l’engagement des jeunes Marocains. Volontaires mais désarmés, mobilisés mais invisibilisés, ils appellent à une démocratie plus accessible, inclusive et connectée.
Contrairement aux idées reçues, la jeunesse marocaine n’est ni passive ni indifférente à la chose publique. C’est la principale conclusion du rapport «Comment les jeunes voient-ils l’engagement citoyen ?», présenté le 17 juillet à Casablanca par l’Association Les Citoyens. Menée pendant une année dans les 12 régions du Royaume et impliquant plus de 1.100 jeunes, l’étude dresse le portrait d’une génération avide d’action mais confrontée à un mur d’incompréhension institutionnelle.
Alors que près de 70% des jeunes interrogés déclarent ne pas faire confiance aux institutions, leur désir de participer demeure vivace : 60% souhaiteraient s’engager davantage s’ils en avaient les moyens. Mais leur participation reste cantonnée à des formes informelles, locales ou numériques, souvent hors des radars des politiques publiques.
Le rapport met en lumière un paradoxe criant : bien que la Constitution marocaine garantisse des dispositifs participatifs (pétitions, motions citoyennes, conseils consultatifs…), ceux-ci demeurent largement inaccessibles. Leur complexité, leur éloignement du terrain et l’absence de retour institutionnel alimentent une frustration silencieuse. Près de 48% des jeunes jugent ces outils peu efficaces, tandis que 42% n’ont jamais pris part à un mécanisme participatif.
Les témoignages collectés lors des Cafés Citoyens (rencontres locales organisées par l’Association) révèlent un profond sentiment de découragement : «Ce n’est pas le désintérêt qui freine les jeunes, mais le manque de ponts concrets vers l’action», déplore Zainab Cherrat, Ambassadrice Mentor de l’ONG à Rabat-Salé-Kénitra.
Le fossé est aussi territorial. Dans les zones rurales, les douars ou les quartiers défavorisés, l’accès aux institutions est souvent inexistant. Résultat : une citoyenneté à deux vitesses, où seuls les jeunes socialement ou scolairement intégrés peuvent prétendre à une participation reconnue.
Dans ces contextes, l’engagement prend des formes alternatives : entraide communautaire, actions écologiques, mobilisations numériques, ou sensibilisation en darija. Des dynamiques précieuses mais rarement reconnues par les instances officielles.
Avec 68% des jeunes utilisant les réseaux sociaux pour aborder des sujets sociaux ou politiques, le digital s’impose comme un levier majeur de participation. Pourtant, l’administration publique y reste quasiment absente, et les plateformes officielles comme chikaya.ma sont jugées inadaptées, peu ergonomiques et trop éloignées des usages des jeunes.
«On fait beaucoup, mais personne ne le voit», résume un participant, pointant le manque de reconnaissance institutionnelle des initiatives citoyennes en ligne. Un découragement renforcé par la fracture numérique dans les zones rurales et l’absence de soutien aux créateurs de contenu citoyen.
L’étude ne se contente pas de dresser un constat alarmant. Elle propose des pistes ambitieuses, inspirées d’expériences internationales, pour reconnecter les jeunes aux institutions : activer les Conseils consultatifs de la jeunesse dans les communes, créer des Fonds régionaux pour soutenir les projets citoyens informels, intégrer une éducation civique pratique dans les programmes scolaires dès le collège, transformer les maisons des jeunes en hubs civiques, lancer une campagne nationale de valorisation de l’engagement jeune : «Les jeunes changent le Maroc».
Sur le plan numérique, les auteurs recommandent également la création d’un observatoire national de l’engagement numérique, la refonte des plateformes institutionnelles en interfaces mobiles multilingues (arabe, amazighe et darija), la mise en place de programmes «Wi-Fi Citoyen» et d’ateliers d’E-participation en zones enclavées, le financement d’un Fonds pour les médias citoyens jeunes…
«La jeunesse marocaine n’est pas désengagée, elle est en mutation», conclut le rapport. Elle ne rejette pas la démocratie, elle exige qu’on la réinvente : plus simple, plus transparente, plus équitable. Pour Les Citoyens, il ne s’agit plus seulement d’inviter les jeunes à voter tous les cinq ans, mais de les associer pleinement à la construction quotidienne du pays.
L. F.