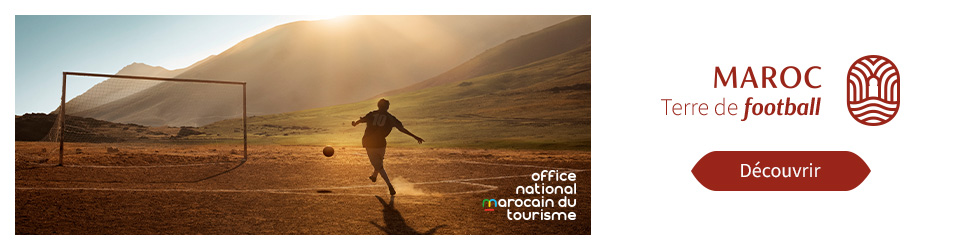Pour une chaîne de valeur nationale dédiée aux déchets électriques et électroniques

Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) préconise la mise en place d’une chaîne de valeur nationale dédiée aux déchets électriques et électroniques. En raison de leur abondance et de leur forte utilisation, les équipements électriques et électroniques génèrent une grande quantité de déchets. Leur volume est passé à 177.000 tonnes et pourrait atteindre 213.000 tonnes d’ici à 2030.
Cette évolution, bien qu’elle soulève d’importants enjeux environnementaux et sanitaires, constitue également un gisement de matériaux qui peuvent être récupérés et recyclés localement au bénéfice de l’économie et du développement durable.
Dans un avis intitulé «Vers une économie circulaire des équipements électriques et électroniques : du déchet à la ressource», le CESE souligne que cette démarche s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le CESE sur la thématique de l’économie circulaire, notamment son avis sur «L’intégration des principes de l’économie circulaire dans le traitement des déchets ménagers et des eaux usées», adopté déjà en 2022.
Le CESE considère que l’exploitation du potentiel que représentent les déchets constitue une opportunité stratégique majeure. Leur recyclage permet en effet de récupérer des matériaux précieux ou réutilisables (tels que les métaux rares, le cuivre ou les plastiques) pouvant être réinjectés dans les chaînes de production. Cette valorisation contribue à la fois à préserver les ressources naturelles et à développer des filières industrielles innovantes et locales, sources d’emplois et de valeur ajoutée.
Toutefois, ce potentiel demeure largement sous-exploité, avec seulement 13% des déchets recyclés depuis 2020, et ce, en raison de plusieurs facteurs. Le cadre juridique en vigueur, peu adapté, limite l’émergence d’une filière structurée, durable et compétitive. Les initiatives publiques et privées, pour leur part, demeurent fragmentées, faute d’une vision commune et d’une coordination suffisante entre les différents acteurs concernés. À cela s’ajoute la forte prédominance du secteur informel, qui détourne une part significative des flux vers des circuits non réglementés, entraînant ainsi des pertes substantielles en ressources stratégiques.