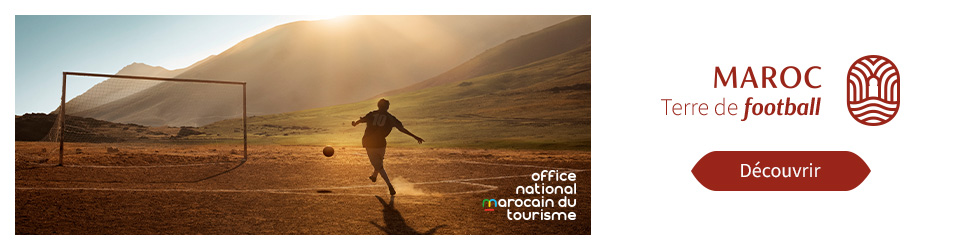Jean-Michel Kibushi et Zouhaier Mahjoub, deux pionniers de l’animation africaine à l’honneur au FICAM

Dans le cadre du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM), une rencontre avec les médias a réuni avant-hier deux figures majeures du cinéma d’animation africain : Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto, de la République Démocratique du Congo, et Zouhaier Mahjoub, de Tunisie. Un moment rare d’échange et de transmission, à la hauteur du parcours de ces deux artistes qui ont marqué l’histoire de l’animation sur le continent.
Face aux journalistes et aux festivaliers, Jean-Michel Kibushi, considéré comme le père de l’animation en Afrique centrale, est revenu sur un parcours hors normes, marqué par un profond ancrage culturel et un engagement citoyen. Fondateur en 1988 du premier studio d’animation congolais, «Malembe Maa», il a ouvert la voie à une génération de créateurs africains. Son œuvre, initiée avec «Le Crapaud chez ses beaux-parents» (1991), puise dans les contes traditionnels tout en abordant des sujets politiques forts, à l’image de «Kinshasa Septembre Noir» qui évoque les pillages de 1991 à travers le regard d’enfants.
Lors de ce débat, Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto a insisté sur la nécessité de «raconter nos propres histoires avec nos propres images», soulignant l’importance de développer une animation enracinée dans les réalités africaines. Il a également évoqué ses projets de transmission, notamment «La Caravane pour le Sankuru», un cinéma itinérant destiné aux populations rurales, preuve de son engagement pour une culture accessible à tous.
À ses côtés, Zouhaier Mahjoub, véritable légende du cinéma maghrébin d’animation, a partagé son expérience riche de plus de six décennies. Formé en Europe dans les années 1960, il a contribué à poser les bases de l’animation en Tunisie, notamment avec la création d’«A.Z.A. Production», la première société tunisienne dédiée à ce genre d’art. Ses films, comme «Les Deux Souris Blanches» et «Le Guerbagi», mêlent humour, critique sociale et mémoire populaire.
Nous lui avons posé la question de savoir comment il voit l’évolution de ce genre d’art sur le continent africain depuis ses débuts. Voici sa réponse : «Depuis mes débuts, j’ai toujours pensé que la technologie, surtout dans le domaine de l’animation, devait être utilisée avec discernement et une bonne maîtrise. J’ai commencé avec des moyens très simples : du papier découpé, des outils que je fabriquais moi-même. Cette approche artisanale m’a permis de comprendre chaque étape du processus, jusqu’au maniement des pellicules. Cela m’a offert une grande liberté et un contrôle total sur mes créations. Aujourd’hui, les outils numériques offrent des possibilités immenses, mais ils présentent aussi de nouveaux défis. Par exemple, en 3D, les logiciels peuvent générer des formes fascinantes, mais pour arriver à un rendu final de qualité, il faut une puissance de calcul que seuls des équipements coûteux peuvent fournir. Et en Afrique, cet accès reste limité. Il est donc crucial d’avoir une solide formation de base, pour pouvoir adapter ses méthodes aux réalités locales sans sacrifier la qualité artistique. En fin de compte, au-delà des outils, l’essentiel reste l’intention et le message. Avec peu de moyens mais une vision claire, on peut raconter des histoires puissantes. L’évolution de l’animation en Afrique centrale, je la vois justement comme cela : une quête d’expressivité, où la créativité prime sur la technologie».
Pour sa part, Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto a renchéri : «L’animation en Afrique a progressé, mais reste encore à ses débuts, notamment en Afrique subsaharienne. L’arrivée de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités, mais il faut veiller à ne pas perdre l’âme artistique au profit d’une création trop mécanisée. Une approche hybride, mêlant technologie et sensibilité humaine, me paraît essentielle. Les équipements nécessaires sont coûteux et énergivores, ce qui freine le développement. Malgré quelques œuvres remarquables, souvent artisanales, la production reste limitée par le manque d’écoles de cinéma et de structures de formation. On dénombre très peu d’institutions dédiées, surtout en dehors du Maghreb. Des initiatives comme le récent sommet à Los Angeles, soutenu par des studios internationaux, montrent un intérêt croissant pour l’animation africaine, mais il faut construire durablement ces dynamiques sur le continent. Le vrai défi reste de former des talents capables de créer et diffuser leurs propres imaginaires, dans un cadre institutionnel encore trop rigide. Un événement majeur, prévu en Roumanie, pourrait offrir un nouvel élan à cette industrie prometteuse».
LAIDIA FAHIM