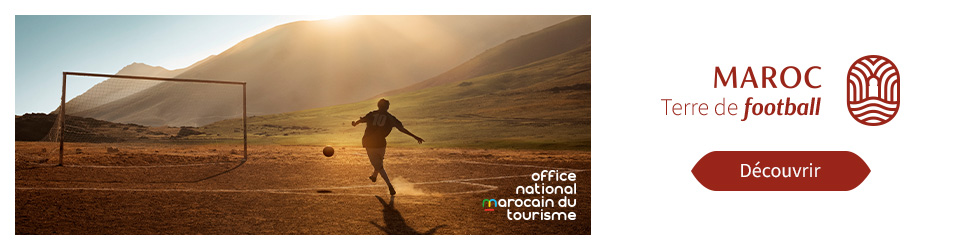Les États-Unis divorcent de l’OMS : quel organe de santé mondiale pour l’avenir ?

Par Dr IMANE KENDILI
Présidente de l’African Global Health, consultante internationale, spécialiste en psychiatrie et addictologie
Et voilà ! Le divorce est consommé entre les États-Unis et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) suite à la décision de Donald Trump, dès sa prise de fonction, au lendemain de son investiture. De quoi présager des horizons bouchés pour l’instance de santé onusienne dans les années à venir.
Le 20 janvier 2025 restera une date lourde de conséquences pour la gouvernance sanitaire mondiale. Dans une décision aussi audacieuse que controversée, le Président Donald Trump a signé un Décret officialisant le retrait des États-Unis de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une annonce fracassante, qui soulève autant de questions qu’elle ne laisse de zones d’ombre. Pour justifier ce désengagement, l’Administration américaine évoque des griefs anciens et profonds : une gestion jugée calamiteuse de la pandémie du «Covid-19», des réformes attendues mais jamais réalisées et une influence politique qu’elle considère outrancière, notamment celle exercée par la Chine.
Point de bascule au profit de la Chine ?
Parmi les points les plus débattus, figurent également la contribution financière disproportionnée des États-Unis qui, en tant que principal bailleur de fonds de l’OMS, assumaient environ 20% de son budget global, soit 679,6 millions d’euros en 2022. Une somme que Washington juge disproportionnée face aux apports de pays comme la Chine, pourtant bien plus peuplée.
Dans les couloirs feutrés de Genève, où siège l’OMS, la stupeur est totale. L’organisation, confrontée à ce qui pourrait être un coup de massue financier, a exprimé son profond regret. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son Directeur Général, a appelé les États-Unis à reconsidérer leur décision, rappelant que les défis sanitaires du 21ème siècle, des pandémies aux résistances antimicrobiennes, exigent une réponse collective.
Mais derrière les déclarations officielles, l’inquiétude est palpable. Ce retrait met en péril des programmes cruciaux de lutte contre des maladies comme le «VIH/SIDA», la malaria ou encore la tuberculose, des fléaux qui continuent de ravager les régions les plus vulnérables du globe.
Pour les experts en santé publique, le choc est immense. Lawrence Gostin, figure respectée du droit de la santé mondiale, qualifie la décision américaine de «coup de grâce» pour les efforts internationaux en matière de santé. «C’est comme retirer un pilier central d’un édifice déjà fragile», déplore-t-il. Ashish Jha, ancien coordonnateur de la gestion des pandémies à la Maison-Blanche, partage cette analyse : «Cette décision ouvre un boulevard à la Chine pour accroître son influence au sein de l’OMS, avec toutes les implications géopolitiques que cela suppose».
C’est bien là que réside l’un des enjeux les plus sensibles de cette décision : les répercussions géopolitiques ! Privée du soutien de Washington, l’OMS pourrait voir la Chine, forte de son expansion diplomatique et de sa stratégie d’investissements dans le Sud global, occuper un rôle dominant. Une redistribution des cartes qui pourrait altérer les priorités sanitaires mondiales, mais aussi l’équilibre des pouvoirs au sein de l’OMS.
Un vœu pieux plus qu’une solution pragmatique
Le retrait américain n’est cependant pas une première. En 2020 déjà, Donald Trump avait enclenché une démarche similaire, stoppée net par Joe Biden à son arrivée à la Maison-Blanche. Mais cette fois, le ton est plus définitif et les alternatives proposées par l’Administration Trump sont plus tranchées : rediriger les fonds vers des initiatives nationales ou bilatérales, tout en identifiant des partenaires jugés plus fiables et transparents que l’OMS. C’est une promesse qui, selon Daniel Lopez Acuna, ancien haut cadre de l’Organisation, relève davantage d’un vœu pieux que d’une solution pragmatique. «Remplacer l’OMS n’est pas une tâche simple. Son rôle ne se limite pas à la gestion des crises; il s’agit d’un réseau complexe qui structure les politiques de santé dans le monde», rappelle-t-il.
Au-delà des considérations financières et diplomatiques, cette décision pose une question plus fondamentale : comment répondre collectivement à des menaces sanitaires qui ne connaissent ni frontières ni souverainetés ? Le retrait des États-Unis ne marque pas seulement une fracture dans la coopération internationale; il souligne aussi les failles d’un système multilatéral qui peine à convaincre et à réformer.
Dans ce jeu d’échecs où chaque mouvement redéfinit les équilibres, l’OMS entre dans une période de turbulences sans précédent. Face à l’urgence, la communauté internationale devra se mobiliser pour préserver l’essentiel : la santé des populations et la capacité à affronter ensemble les crises à venir. Mais pour l’instant, l’avenir s’assombrit et un monde déjà divisé semble s’éloigner un peu plus de l’idéal d’unité qui, autrefois, était son socle !