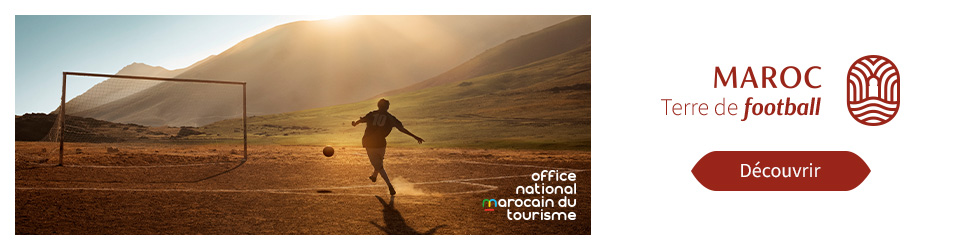Lutte anti-terroriste : le Maroc en première ligne

Par MUSTAPHA SEHIMI
Professeur de droit, Politologue.
Oui, la situation actuelle est difficile avec l’impact de la triple crise sanitaire, sociale et économique que l’on doit à la pandémie du «Covid-19». Mais cela n’évacue point de grands dossiers, aucunement conjoncturels et relevant d’intérêts nationaux supérieurs. Celui du Sahara marocain, davantage consolidé avec la reconnaissance de la marocanité de nos provinces méridionales récupérées, par l’Administration américaine, décidée par l’ancien président Trump et entérinée par son successeur, Joe Biden. Celui aussi de la sécurité du Royaume confronté, comme la majorité des pays, au jihadisme sous telle ou telle franchise terroriste.
Depuis les attentats de Casablanca de mai 2003, voilà bien une donne majeure qui a été gravement prise en compte par le Maroc. Celle-ci s’est, depuis, déclinée en étapes successives qui ont conduit à une sorte de «Made in Morocco», une boîte à outils permettant d’optimiser les actions et les résultats d’une politique proactive inscrite au registre d’une stratégie pluridimensionnelle. Dans cette même ligne, figure au fronton, la DGST (NDLR : Direction Générale de la Sécurité du Territoire) et son instrument judiciaire, le BCIJ (NDLR : Bureau Central des Investigations Judiciaires).
La DGST ? Elle a capitalisé depuis des années une crédibilité à l’international. Voici trois mois, c’est le FBI (section de New York) et la CIA qui ont adressé des messages de félicitations et de gratitude à cette institution sécuritaire nationale. Ils y saluent le niveau de coopération et de partenariat avancé qui lient ces organes. Une mention particulière est faite aux renseignements précis fournis par la DGST, lesquels ont permis de contribuer à la neutralisation du danger terroriste. L’exemple le plus récent a trait à des informations données qui ont accéléré l’enquête du FBI au sujet du soldat américain Cole James Bridges. En relation avec l’organisation Daech, il planifiait une opération terroriste ciblant des intérêts US au Moyen-Orient
La «Martingale» du Maroc…
Une doctrine marocaine de lutte antiterroriste a été élaborée au fil des ans. Elle a conduit à une accumulation d’un savoir-faire et d’un savoir-agir qui a fini par porter ses fruits. Le Royaume a su ainsi réarticuler et redimensionner sa stratégie sécuritaire. Il est considéré comme «un maillon fort» de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Il a, en effet, apporté une réponse coordonnée d’action et de coopération régionale, continentale et, plus spécifiquement, euro-méditerranéenne en matière d’antiterrorisme.
Pour Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), un think tank spécialisé, c’est sur cela que réside la «martingale» qui donne ce statut et cette influence au Maroc. Il faut y ajouter l’identité et la visibilité du «modèle marocain d’un Islam du “juste milieu”, serein, équilibré et modéré», le statut religieux du Roi, Commandeur des croyants, la résilience du tissu social ainsi que la restructuration du champ religieux depuis près d’une vingtaine d’années. Le rôle du Maroc ne peut que s’affirmer davantage. Référence est faite au cadre offert par l’initiative dite du terrorisme, proposée par les ministres de la Justice de France, de Belgique, d’Espagne et du Maroc. Le Maroc assume pleinement ce partenariat : il informe, alerte et partage les informations dont il dispose.
Lien «Polisario»
Le mois dernier, le Maroc a assisté au sommet du GS du Sahel. Il a insisté pour une «action d’envergure» contre le terrorisme. C’est que cet espace représente un grand danger pour la région et, partant, un grand défi sécuritaire pour le Maroc. Un nouveau directeur du Bureau Central des Investigations Judiciaires, Habboub Cherkaoui, nommé à la fin novembre, a succédé à Abdelhak Khiame en poste depuis plus de cinq ans. Il a rappelé que c’est de cette région que provient aujourd’hui la menace terroriste pesant sur le Royaume et les pays voisins; une «zone grise» confrontée à des troubles socio-économiques, mais aussi à des interférences étrangères. Les deux principales organisations terroristes, Al Qaida et Daech, ont trouvé dans le Sahel un terrain favorable, après leur retrait et leur échec en Afghanistan et en Syrie. L’on trouve aujourd’hui dans le Sahel plusieurs organisations actives : certaines liées à AQMI (Al Qaida au Maghreb Islamique), d’autres à Al Qaida, sans oublier celle de l’État Islamique dans le Grand Sahara (EIGS) avec à sa tête Adnane Abou Walid Al-Sahraoui. Natif de Laâyoune, c’est un ancien membre actif du «Polisario» qui a revendiqué plusieurs opérations terroristes dans la région. Une prime de 5 millions de dollars est d’ailleurs offerte par les États-Unis pour sa localisation.
Groupes terroristes
Nul doute : il y a bien un lien entre les groupes terroristes et le mouvement séparatiste. Le nouveau patron du BCIJ a donné des précisions significatives à cet égard : une bonne centaine d’éléments armés du «Polisario» actifs au sein d’Al Qaida au Maghreb Islamique, un encadrement militaire dans les camps de Tindouf, un endoctrinement jihadiste par des «imams». Dans tout cela, si le Maroc coopère étroitement avec les pays de la région et même au-delà, tel n’est pas le cas de l’Algérie. Une situation condamnable qui témoigne du parrainage de ce voisin de l’est, sous telle ou telle forme, de tous ces groupements terroristes et de visées propres aux généraux d’Alger.
Le BCIJ a cependant pris toute la mesure de la gravité de la situation qui prévaut dans cet espace régional. Face à la «Daech-Connexion», ce département fait montre de veille, de vigilance et de capacité d’anticipation. Il faut rappeler à ce sujet que pas moins de 1.654 Marocains ont rejoint l’organisation terroriste de l’État Islamique depuis 2014. L’on compte 270 d’entre eux qui sont rentrés au Maroc et 137, dans ce lot, qui ont pu être déférés devant la Justice. 115 ont été actifs dans la zone syro-irakienne, 14 en Libye et 8 autres rapatriés en 2019, en coordination avec les États-Unis. Il faut préciser aussi quelque 300 femmes (une centaine de femmes étant rentrées), mais aussi 391 enfants dont 82 de retour. L’on a bien affaire, en dernière instance, à des éléments armés formés à la fabrication des explosifs et de poisons mortels. Le Maroc demeure vigilant : il considère que tous ceux qui ont rejoint les organisations terroristes sont des présumés terroristes.
Un bilan remarquable sanctionne cette politique antiterroriste. Depuis sa création en 2015, l’on peut en juger : 82 cellules démantelées dont 76 en relation avec l’État Islamique, 1.338 personnes interpellées. Durant les deux décennies écoulées, ce bilan est encore plus éloquent avec le démantèlement de 202 cellules. En 2020, 8 cellules terroristes ont été neutralisées, 3.535 personnes ont été interpellées et plus de 500 projets terroristes dévastateurs ont été mis en échec.
Coordination sécuritaire
D’année en année, la politique sécuritaire du Maroc porte ses fruits avec un recul significatif du nombre des cellules terroristes démantelées. Preuve que l’action menée par la Direction Générale de Surveillance du Territoire, assurée par Abdellatif Hammouchi depuis le 15 décembre 2005, a été efficace : il s’est également vu confier celle de la DGSN (NDLR : Direction Générale de la Sûreté Nationale) le 15 mai 2015. La collaboration est étroite entre les différents services en charge de la sécurité. Il n’y a pas de cloisonnement; bien au contraire, cela permet une coordination continue et opératoire avec d’autres départements, notamment la Gendarmerie Royale.
Cette politique et la stratégie dans laquelle elle s’insère a permis au Maroc d’éviter des bains de sang .Il s’agit là de la rançon d’un haut sens de professionnalisme, de rigueur et d’efficacité. Elle participe d’une double préoccupation : celle de la défense de la sécurité du Royaume et celle d’une forte implication dans la lutte internationale contre le terrorisme. Son crédo ? Ce triptyque : vigilance, anticipation, action. La DGST et son bras judiciaire armé le BCIJ, sont continuellement en alerte. Comme l’a rappelé Abdelhak Khiame, à la fin de novembre dernier, «le risque terroriste pèse énormément sur notre pays». Et d’ajouter encore : «Les services de sécurité restent concentrés sur ce risque permanent qui guette le pays et redoublent d’efforts et de vigilance pour assurer et sauvegarder la sécurité de notre pays».
Une approche multidimensionnelle
Mais il y a plus. Ainsi, la stratégie marocaine ne se limite pas à ce seul aspect sécuritaire, tant s’en faut. Elle se veut adossée à une approche globale couvrant d’autres domaines, législatif, religieux, social aussi. Une politique avant-gardiste reconnue et saluée aux niveaux régional et international. Les orientations Royales sont l’axe et la feuille de route. Elles sont la traduction des exigences de la légitime défense de la communauté nationale, une responsabilité régalienne dont le Souverain a la charge politique, institutionnelle et religieuse. La situation des détenus condamnés pour terrorisme et extrémisme violent est également éligible à l’approche multidimensionnelle du Maroc, englobant le volet sécuritaire bien entendu, mais aussi les volets d’intégration et de qualification comme l’ensemble de la population carcérale. Des programmes spécifiques sont prévus et appliqués. Ils visent la qualification de ces détenus, tel celui baptisé «Moussalaha», tourné vers le renforcement des valeurs de tolérance et de modération. La Rabita Mohammedia des Oulémas y apporte d’ailleurs sa contribution. Elle s’emploie à protéger et à immuniser ces catégories en les convainquant de rejeter l’extrémisme, de déconstruire un certain discours religieux qui le véhicule et de démonter ses mécanismes et son appareil conceptuel. De nouvelles réponses à de nouveaux défis…