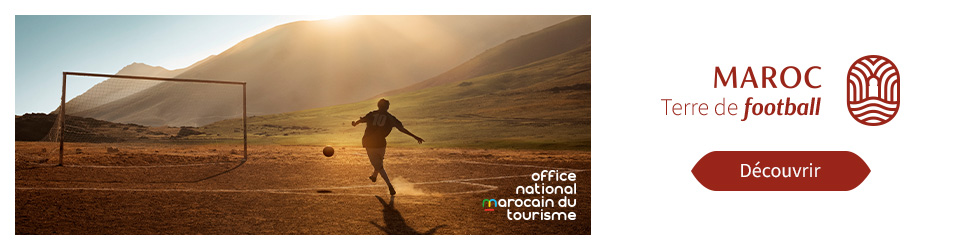Le cinéma marocain est-il grandi par «Le Bleu du Caftan ?

Par HASSAN EL ARCH
Directeur de la Rédaction
Comme plusieurs centaines de spectateurs, j’ai été faire la queue, mardi dernier au Mégarama Casablanca, pour l’avant-première du film «Le Bleu du Caftan». C’est le dernier trip de Nabil Ayouch. Commis en 2022, mais en campagne en 2023 au Maroc. Primeur de l’étranger oblige… Mon impression à chaud, puis largement à froid ? Une «hachouma» monumentale !
Nabil Ayouch est coutumier du fait. Tous les trois ou quatre ans, son subconscient lui susurre de faire une «sortie» contre la part marocaine de son être. Cette demi-marocanité est un bug identitaire qui lui fait mal, on le comprend, le fait souffrir et lui voile la vision qu’il porte sur ses racines. Alors, il tente de l’expurger de son référentiel anti-marocain à coup de films tout aussi anti-marocains. Il n’y a pas d’autres mots quand on a vu ce «Bleu du Caftan», «Haut et fort» (2021), «Razzia» (2017), «Much Loved» (2015), «Les chevaux de Dieu» (2012) ou même «Ali Zaoua» (2000). La moitié de sa filmographie est consacrée à un seul et unique objectif : «dézinguer» les valeurs marocaines et la société qui s’en nourrit. Quand il ne met pas lui-même en scène, Nabil Ayouch «sous-traite» la réalisation ou le scénario auprès de Maryam Touzani, sa femme cinéaste au long cours, réalisatrice du film «Le Bleu du Caftan». Invariablement, ses films crachent sur ce que la moitié des Marocains respecte, l’autre moitié ayant un regard mitigé entre défiance et indifférence.
Ce film immonde a, semble-t-il, raflé 37 Prix internationaux. C’est ce qu’a déclaré Nabil Ayouch himself lors de l’avant-première, mardi dernier. Faut-il préciser que ces Prix n’ont pas été décernés parce que «Le Bleu du Caftan» crève l’écran, artistiquement ou techniquement parlant ? Non. Le film est d’un ennui mortel. Deux heures totalement soporifiques. Une médiocrité textuelle de la première à la dernière minute dans les dialogues. Des gros plans improbables. Une «œuvre» qui aurait amplement tenu dans la moitié de la pellicule ! Non, le film a raflé ses Prix en récompense de la gadoue jetée sur les valeurs de la société marocaine. Certaines séquences suscitent le dégoût. La caméra insiste sur des scènes bien cadrées au hammam des hommes et l’on découvre une «réalité» nabilo-ayouchienne : au Maroc, les hammams sont dotés de cabines individuelles ouvertes aux hommes qui souhaitent forniquer en toute tranquillité. Au su de tout le monde…
Nous sommes, nous aussi, coutumiers du fait : l’Occident aime regarder d’en haut les sociétés arabes et musulmanes. Sa posture est au confluent de la condescendance et du mépris. La plupart des festivals et des Fondations œuvrant dans le 7ème Art distribuent des bons points aux cinéastes qui tirent à boulets rouges sur l’arabité et l’islam. Pour émarger aux palmarès de ces faiseurs de stars, il faut descendre les modèles sociaux et culturels du Maroc, de la Tunisie, d’Égypte, d’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, d’Irak, de Palestine ou de Turquie. Évidemment, la «prime» est d’autant plus médiatisée que le metteur en scène, le producteur ou le scénariste portent la nationalité de ces pays.
Le cinéma marocain est-il grandi par le travail de Nabil Ayouch ? On se pose la question en pensant, par exemple, à Nour-Eddine Lakhmari, Farida Benlyazid, Faouzi Bensaïdi, Narjiss Nejjar, Ahmed Boulane ou encore Hakim Noury…